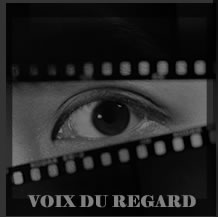Ness El Fen
Samedi 5 avril
A 11h
Le documentaire confronté au défi d’un nouveau média :
le téléphone portable.
En intégrant une caméra et un appareil photographique, le téléphone portable devient un outil de communication complet, qu’on appelle désormais smartphone, le téléphone intelligent. Sa nature individuelle, privée et intime lui permet de rendre la séparation entre sphère privée et sphère publique complètement poreuse, voire caduque. C’est ainsi que sont révélés des scandales sur les affaires très privées de personnalités publiques filmées à leur insu. Par ailleurs, l’explosion des moyens de diffusion via Internet et les sites de partage de vidéo tels que YouTube et Dailymotion détruit le monopole de l’information constituée par les mass medias conventionnels.
Tout événement peut donc être relayé par n’importe qui. N’importe qui peut être paparazzi, reporter, mettre en lumière des événements sans passer par les filtres que constituent les médias traditionnels. D’une part, les gens peuvent et veulent coller à l’événement. D’autre part, les gens créent l’événement. De nouveaux phénomènes sociaux de création audiovisuelle foisonnent du fait de l’explosion des possibilités de diffusion.
Cette dernière catalyse et amplifie le mimétisme (mais aussi le voyeurisme ; on pense aux photos prises par les soldats américains dans la prison d’Abou Ghraïb en Irak). Le fait que le nombre de personnes qui ont visionné des vidéos sur ces sites soit comptabilisé permet, par un effet boule de neige, de faire émerger de nouvelles visibilités sociales (le top 10 des vidéos les plus visionnées). Le phénomène, en soi, produit le besoin et les outils pour l’établissement d’une cartographie des comportements sociaux.
Exemple : Le Happy slapping est une pratique consistant à filmer l'agression physique d'une personne à l'aide d'un téléphone portable. Le terme s'applique à des gestes d'intensité variable, de la simple vexation aux violences les plus graves, y compris les violences sexuelles. La banalisation et la disponibilité de caméras vidéo jouent comme un facteur de motivation supplémentaire pour la planification et le passage à l’acte.
Doc à Tunis s’interroge sur les perspectives et les risques qu’implique l’usage de plus en plus généralisé d’un tel outil de communication.
Comment, avec son appréhension subjective de la réalité, le documentaire peut-il se confronter à ces nouvelles institutions imaginaires et sociales ? Quelles projections des significations deviennent possibles ? L’éthique étant au coeur de la pratique du documentaire, comment celui-ci pourra-t-il s’adapter, évoluer ? |